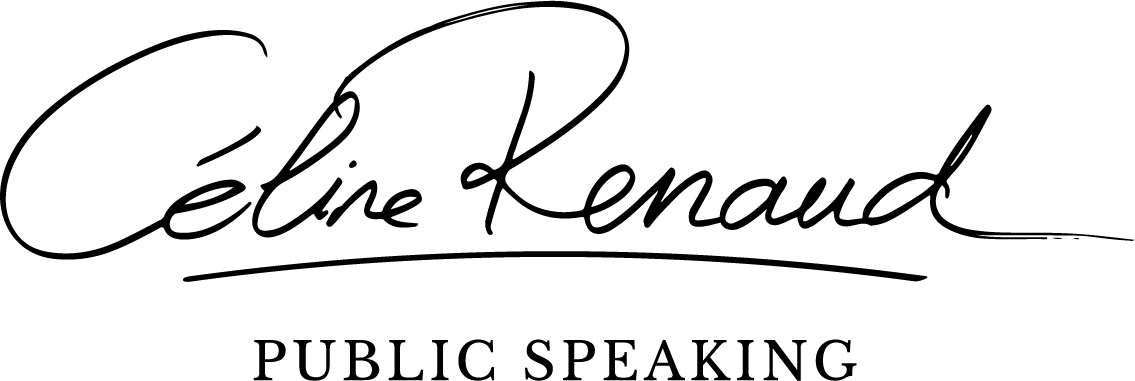Pourquoi la communication orale est-elle sous-estimée par rapport à la communication écrite en entreprise ?

Un mardi matin, à 11 heures, je participe à un forum sur la durabilité au sein d’un grand centre de congrès. Après avoir modéré la séance plénière, j’assiste à un atelier animé par un représentant d’un sponsor majeur de l’événement. Il commence par un « bonjour » peu engageant, alors que nous sommes ensemble depuis 8h30, suivi de quelques phrases à peine audibles en raison du faible volume de sa voix. Malgré les remarques des participants, il reste campé derrière un pupitre sans micro, faisant défiler des diapositives surchargées de texte illisible, tant par la taille de la police que par le contraste avec le fond.
Assise au fond de la salle, je constate que la plupart des spectateurs ont déjà décroché. Quelle image les gens doivent-ils avoir de lui, et surtout de sa société pourtant bien connue et surtout de la qualité de leurs services ? Nous devons encore subir 45 minutes de cette présentation avant d’entamer enfin la partie d’échanges avec le public. Je ne tiens plus et finis par quitter discrètement la salle, consternée par le montant investi par ce sponsor et la médiocre performance de son représentant.
Cette situation me fait réfléchir à la différence de traitement entre la communication orale et la communication écrite ou visuelle, largement soutenue par des investissements astronomiques dans les entreprises. Le fossé est énorme ! Sans compter le gaspillage de temps et d’argent dans des sessions mal préparées et mal modérées. Cela donne le vertige …
Alors, pourquoi la communication orale est-elle sous-estimée ? Nous vivons à une époque dominée par le visuel, où ce qui peut être vu est souvent considéré comme démontré. Les entreprises soignent généralement leur communication écrite et visuelle, mais négligent l’oralité, peut-être parce qu’éphémère et la considérant comme un simple passage obligé sans y mettre l’attention nécessaire, ou encore parce que « c’est le fond qui compte. » Cette attitude est souvent héritée du monde académique. Comme j’interviens auprès de bon nombre de nos institutions académiques, j’observe que ce constat sur le fond au détriment de la forme trop souvent est partagé : si la forme est mauvaise, le fond risque de ne pas être partagé, transmis ou compris.
Pourtant, l’histoire nous montre que la transmission orale a été cruciale pour la préservation de la culture, des traditions et des connaissances. Des textes comme l’Ancien Testament ou la Torah, qui ont d’abord été transmis oralement pendant des siècles avant d’être écrits, en sont un exemple. L’oralité a le pouvoir unique de transmettre des émotions de manière puissante, ce qui reste gravé dans les mémoires bien plus longtemps que des mots.
Une communication orale bien maîtrisée renforce la conviction, inspire à l’action, crée des liens et provoque de véritables changements. Il est grand temps d’allouer un véritable budget à votre communication orale.
Kateb Yacine, écrivain : « C’est l’oralité qui donne le corps et le rythme à la poésie. Rester dans l’écrit, c’est comme si nous lisions uniquement une chanson sans la chanter. »